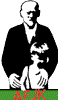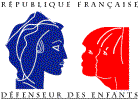Aurait-on imaginé de pouvoir lire une interview de Korczak ? C’est pourtant la surprise que nous a offerte la Défenseure des Enfants, Claire Brisset, en novembre 2002, à l’occasion de la Journée internationale de droits de l’enfant. À cette époque, une rubrique très suivie de son site Internet, disparue depuis, accueillait régulièrement les interviews des personnalités influentes du monde de l’enfance, et Claire Brisset qui rendait souvent hommage à Janusz Korczak avait imaginé cette formule pour faire mieux connaître celui qu’elle considérait comme le père spirituel de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Publié sur korczak.fr depuis 2003 avec l’autorisation de Claire Brisset et de son véritable auteur, Anne Terrier, qui faisait partie de son équipe.
- Janusz Korczak, vous avez consacré votre vie aux enfants. Quelle enfance avez-vous eu ?
- J.K. : Je suis né le 22 juillet 1878, à Varsovie. Mon père était avocat, Ma sœur et moi étions très choyés, très protégés. Et puis, tout d’un coup, notre vie a basculé lorsque j’avais 12 ans. Notre père a été interné en hôpital psychiatrique où il est mort quelques années plus tard. Comme il ne travaillait plus, nous avons eu de graves difficultés financières.
- Vous avez pourtant réussi à faire des études de médecine ?
- J.K. : Je donnais des leçons particulières pour payer mes études et aider ma famille. Dès que j’ai eu mon diplôme, j’ai été mobilisé et envoyé au front de la guerre russo-japonaise (1904-1905). À mon retour, je me suis spécialisé en pédiatrie : j’ai été formé dans des hôpitaux de Paris, de Berlin et dans des établissements pour enfants de Londres et Zurich. Puis j’ai ouvert un cabinet à Varsovie tout en exerçant à l’hôpital.
- Pourquoi n’avoir pas conservé votre véritable nom, Henryk Goldszmit ?
- J.K. : Vous savez, les écrivains aiment bien prendre un pseudonyme. C’est ce que j’ai fait quand j’ai commencé à écrire des pièces de théâtre. En Pologne, beaucoup de gens — comme votre ami Stanislas Tomkiewicz, par exemple — m’ont connu en tant qu’auteur de livres pour enfants. Il faut dire que certains de mes livres, en particulier Le roi Mathias Ier et Le roi Mathias sur une île déserte, sont devenus des classiques de la littérature enfantine
- Quelle est, d’après vous, la raison de ce succès ?
- J.K. : Mes histoires pour enfants ont toutes un point commun : elles décrivent les rêves de tout enfant de devenir l’égal des adultes, de ne plus être une minorité opprimée. Mais leurs rêves se heurtent sans cesse à la réalité, à savoir l’incompréhension des adultes, sauf lorsqu’ils disposent de pouvoirs surnaturels comme Gaëtan le magicien. Il est probable que les enfants, mais aussi les adultes qu’ils sont devenus, se reconnaissent dans cette vision du monde.
- Vous pensez que les enfants de tous les pays sont opprimés ? Qu’ils n’ont pas véritablement « droit de cité » dans notre monde ?
- J.K. : Évidemment ! Pourquoi croyez-vous que j’ai demandé, en 1913, la création d’une association internationale pour la protection de l’enfance ? Que j’ai participé, en 1919, au Comité de protection de l’enfance et soutenu, en 1924, la Déclaration de Genève sur les droits de l’enfant ?
- En 1929, j’ai publié une brochure intitulée Le droit de l’enfant au respect dans laquelle je montre comment les adultes traitent les enfants : tantôt avec indulgence, tantôt avec brutalité, mais toujours avec le même irrespect. La plupart du temps, ils sont excédés de ne pouvoir contrôler celui qui est pareil à un aventurier, un ivrogne, un révolté, un fou. C’est parce que l’enfant n’est pas souvent ce que nous voudrions qu’il soit que nous le traitons si mal. J’affirme que l’enfant a droit au respect : du respect pour son ignorance, du respect pour ses échecs et pour ses larmes, du respect pour les mystères et les à-coups de ce dur travail qu’est la croissance, du respect pour les minutes du temps présent. En bref, l’enfant a le droit d’être ce qu’il est.
- À l’époque, c’était une idée totalement révolutionnaire. À la suite de cette publication, j’ai donné des cours à la section pédagogique de l’Université libre polonaise, et à l’Institut national de formation des instituteurs. J’ai également animé des émissions de radio dans lesquelles je dialoguais avec les jeunes, leurs parents ou leurs éducateurs. C’est de là que vient mon surnom de « Vieux docteur », car l’émission s’intitulait « Les petites causeries du vieux docteur ».
- Vous êtes donc un théoricien des droits de l’enfant ?
- J.K. : Pas du tout, bien au contraire ! Tout d’abord, je suis trop indépendant pour appartenir à, ou fonder, quelque courant de pensée que ce soit. Je me suis toujours tenu à l’écart des grands courants idéologiques ou scientifiques de mon époque, marxisme et psychanalyse notamment.
- Ensuite, les ouvrages, les articles, les conférences que vous connaissez ne sont que le reflet de mon expérience pratique. J’ai commencé par aider les enfants des quartiers pauvres de Varsovie — à l’époque, j’étais encore étudiant — ; puis, je me suis occupé de colonies de vacances, j’ai travaillé dans les hospices pour enfants ukrainiens. J’étais, comme on dirait aujourd’hui, éducateur. Surtout, j’ai créé en 1912 et dirigé durant près de trente ans la « Maison de l’orphelin », orphelinat pour enfants juifs, et codirigé à partir de 1919 « Notre Maison », orphelinat pour enfants catholiques. Vous remarquerez d’ailleurs que si notre société avait respecté les enfants, elle n’aurait pas opéré une distinction, fondée sur l’appartenance religieuse imposée par les parents, entre ces deux maisons aux principes de fonctionnement identiques.
- Quels étaient ces principes ?
- J.K. : Vous voulez dire : quels sont ces principes ? Car ces orphelinats existent toujours à Varsovie ; encore maintenant, on y envoie en stage des étudiants qui se destinent à être éducateurs.
- Les principes de ces institutions sont justement ceux d’une pédagogie du respect et de l’autogestion. En effet, elles fonctionnent en « Républiques des enfants » : le Tribunal des enfants, qui se réunit chaque semaine, gère la vie collective, la discipline, et arbitre les conflits. La « Gazette » et le « Code » du Tribunal des enfants permettent également une socialisation des enfants par le biais de l’auto-éducation et de la solidarité. « La petite revue », premier journal au monde à être rédigé et dirigé par des enfants, est un exemple de pédagogie active. C’est également un excellent régulateur des mots et des actes.
- Comme vous voyez, on est loin de l’éducation classique, avec son culte de l’autorité et de la hiérarchie. Et si j’ai intitulé mon traité de pédagogie, publié en 1920, Comment aimer un enfant c’est pour que l’on sache qu’aimer un enfant est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour réussir son éducation. Car notre amour peut être étouffant, il peut empêcher un enfant de s’épanouir et de devenir autonome.
- Pourquoi avoir, en 1912, abandonné la pédiatrie ? Cela semblait pourtant un bon moyen pour vous occuper des enfants ?
- J.K. : Lorsque j’étais pédiatre, je soignais les enfants de famille aisées. Mais les enfants des orphelinats ou les enfants des rues sont des enfants difficiles, souvent violents, à la limite de la délinquance. C’est pour eux que j’ai développé une pédagogie qui tente de surseoir à la violence. Je leur ai dit : « D’accord, vous avez le droit de vous battre, mais à une condition : vous devez prévenir l’autre par écrit au moins 24 heures à l’avance ». Et là, avec la boîte aux lettres - la boîte des bagarres -, ils sont obligés de réfléchir, de s’expliquer, de formuler leur violence. Et cela change tout ! J’ai donc abandonné la pédiatrie au moment où j’ai décidé de me consacrer à ces enfants difficiles.
- Comment se fait-il que vous n’ayez pas eu d’enfants, vous qui leur portez tant d’amour ?
- J.K. : A l’âge de 33 ans, j’ai décidé de ne pas fonder un foyer. J’estime qu’un esclave n’a pas le droit d’avoir des enfants. Je suis juif, polonais, et mon pays était alors occupé par les troupes tsaristes. Alors j’ai fait un choix : servir l’enfant et sa cause.
- L’avenir m’a d’ailleurs donné raison : je me suis battu pour la Russie contre le Japon, puis contre la Russie pour l’indépendance de la Pologne (c’était en 1919) ; j’ai connu l’emprisonnement pour appartenance à l’élite polonaise (1909), les pogroms de 1920, et le ghetto de Varsovie à partir de 1940. Comme je le dis dans mon Journal : « J’ai eu une vie difficile, juste le genre de vie que je voulais, difficile mais belle, riche et sublime ».
- Vous laissez à la postérité de nombreux écrits, les deux orphelinats de Varsovie, des principes éducatifs reconnus dans le monde entier. Y a-t-il autre chose ?
- J.K. : Oui, la Convention internationale des droits de l’enfant. Elle a été demandée en 1979 aux Nations unies par mon pays, la Pologne, qui s’est référé explicitement à mon travail. Certes, il a fallu de longues années pour que ce projet aboutisse, mais enfin, ça y est.
publiée sur le site du Défenseur des enfants, novembre 2002.
______________________
Source
Interview réalisée à partir des ouvrages de Janusz Korczak Comment aimer un enfant suivi du Droit de l’enfant au respect, Éditions Robert Laffont, Paris, 1988. [Les deux titres ont été réédités depuis].
Autres publications :
- Le site suisse aidh.org [https://www.aidh.org/DE/entretien_jk.htm]
- Numéro spécial du Bulletin des droits de l’enfant du CG-93 20 novembre 2005, p. 4 (extrait).
Pour citer cet article
TERRIER Anne : « Interview imaginaire de Janusz Korczak », entretien fictif sur le parcours et l'œuvre du fondateur des droits de l'enfant, inédit publié sur le site du Défenseur des enfants (Claire Brisset) entre nov. 2002 et 2006 ; Association Frse J. Korczak, 3 p., [en ligne sur korczak.fr]